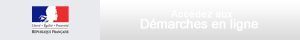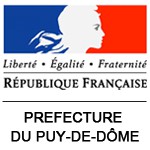Un point sur les fouilles menées sur le plateau de Corent par l'équipe de Matthieu Poux - Eté 2007.
Depuis 2001, des campagnes de fouilles sont menées sur le plateau de Corent. Elles offrent, chaque année, leur lot de découvertes aussi insolites et prestigieuses les unes que les autres. Ces dernières constituent, par ailleurs, une base certaine pour étudier la vie de nos ancêtres gaulois et romains.
Dans les années 90, quelques archéologues de renom, tel Vincent Guichard (aujourd'hui président de l'Association pour la Recherche sur l'Age du Fer en Auvergne - ARAFA - et directeur général du centre archéologique européen du Mont Beuvray), avaient entrepris d'ouvrir des tranchées d'une cinquantaine de mètres carrés. Cela restait relativement insuffisant pour réellement comprendre le mode de vie de nos ancêtres mais avait tout de même permis la mise en évidence d'un grand sanctuaire d'époque romaine.
Depuis 2001, de nouveaux programmes de recherche, étalés sur plusieurs années, ont donné naissance à des chantiers de fouilles d'une surface de 1000 à 3000 m² par an. A l'heure actuelle, environ un hectare sur les 60 qu'offre le site, a été passé au crible.Ce site archéologique du Puy-de-Corent recèle donc de nombreux vestiges datés du néolithique (Troisième millénaire avant J.-C.) à la fin de l'époque romaine (quatrième siècle après J.-C.) : habitations, sépultures collectives et nombreuses haches en pierre, tombes et armes en métal, des milliers de monnaies et tessons d'amphores à vin, etc.
Sous la direction de Matthieu Poux - professeur d'archéologie - une équipe internationale, composée de plus de trente fouilleurs - français, canadiens, russes - d'horizons divers (étudiants en archéologie, en histoire, bénévoles, etc.) se consacre, en cette période estivale 2007, à dégager les vestiges situés cet oppidum, cette grande ville gauloise, vaste de plusieurs dizaines d'hectares. Encore une fois, la multitude d'objets trouvés témoigne de la richesse du site de Corent : citerne à eau, cave comblée d'amphores, armes, parures, fibules et autres bâtiments.
"Vincent", moscovite, étudiant à l'université de Moscou en archéologie médiévale, a choisi de revenir pour la 2e année consécutive sur ce plateau emblématique, non seulement pour apprendre la langue française mais aussi et surtout pour participer à sa manière à la découverte de multiples "trésors" du plus grand intérêt d'un point de vue historique, scientifique, émotionnel et visuel... particulièrement séduit par les méthodes de recherches employées.
Une base de proximité pour des conditions de travail optimale et une diffusion plus large :
Les archéologues ne se cantonnent pas à trouver et déterrer des vestiges enfouis depuis des millénaires sur un site. Leur journée de travail est souvent bien remplie. Sur le plan pratique, un chantier de fouilles fonctionne comme « une petite entreprise » qui mobilise plusieurs bénévoles pendant plus de quatre mois, entre juillet et octobre : fouille sur le terrain, mais aussi, prises de vue, relevés d'altitude, dessins précis, transport, tri, lavage, pesée, comptage, conditionnement en sachets et en caisses de plusieurs tonnes d'objets, classement, mise au net d'une abondante documentation, plans… sont au programme. Tout ceci implique une chaînes d'opérations complexes, menées parallèlement à la fouille et même plusieurs mois après la clôture du chantier, afin de permettre la remise d'un rapport avant la fin de l'année. La base proposée par la municipalité des Martres-de-Veyre, située dans la « Maison du Patrimoine », est spécialement aménagée pour répondre à ces nombreux besoins en mettant à disposition des archéologues des salles de stockage et de lavage du mobilier, des espaces de travail, des installations sanitaires, un petit réfectoire, etc. ainsi qu'une grande salle d'exposition et de médiation accessible au public.
Les travaux de cette équipe de recherche sont diffusés à l'échelle nationale et européenne.
Plus d'infos sur - www.luern.fr (site internet consacré aux fouilles archéologiques du Puy-de-Corent)