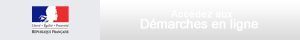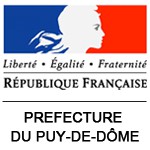Le déplacement du centre paroissial se précisa au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. En 1703, le mauvais état de l’église de Saint-Martial la fit interdire par l’évêque mais les défunts de la paroisse étaient toujours enterrés là-bas. Vers 1730, un nouveau cimetière fut aménagé dans le quartier Saint-Jean (actuelle place des Poilus), beaucoup plus proche de l’église des Martres. La grande crue de 1789 acheva la destruction de l’église de Saint-Martial. Sur le cadastre commandée en 1802 par la municipalité et livré... en 1813 par le géomètre, il ne subsiste pas la moindre trace d’habitation à Saint-Martial.
Au XVIIIe siècle, le bourg des Martres est réputé pour son vin et ses fruits. Le vignoble recouvre une grande partie des terres cultivables, coteaux et plaines, tandis que les prairies bien irriguées abritent les vergers. On cultive également le chanvre qui permet de fabriquer du fil, de la toile, des cordes. Les nombreux noyers qui bordent les chemins fournissent une huile précieuse pour les besoins alimentaires et l’éclairage. Ces diverses cultures nécessitaient une main-d’œuvre importante et la population comptait de nombreux journaliers, confrontés à la précarité, une fois l’hiver venu. En complément à ces activités agricoles, on trouvait des tonneliers et des tisserands. Une grosse partie de ces productions était exportée par l’Allier au moyen de bateaux appelés sapinières. Le vin et les fruits étaient dirigés vers Paris, Moulins, Nevers, le chanvre et l’huile vers Orléans et Nantes. Les Martres disposaient d’un port important qui desservait également les communes voisines. On y débarquait du charbon provenant de Brassac ou de la Taupe pour les besoins de la consommation locale.
Les bateaux étaient fabriqués à Jumeaux, Brassac, Vezezoux. Il en existait de plusieurs dimensions. Les plus courants mesuraient environ 20 mètres sur 4. La navigation s’effectuait presque uniquement à l’avalaison, pendant les périodes de grosses eaux (novembre à avril). Arrivés àdestination, les bateaux étaient démontés et vendus comme bois d’œuvre ou de chauffage. Les mariniers regagnaient leurs foyers à pied, dilapidant souvent leur maigre pécule au gré des auberges rencontrées sur le chemin du retour. Ils formaient une corporation très fermée, aux coutumes bien particulières. Ils vénéraient saint Nicolas, leur patron, dont le souvenir s’est perpétué aux Martres, et beaucoup se distinguaient par l’anneau d’or qu’ils portaient à l’oreille.
Les eaux de la Monne alimentaient des biefs, appelés «béals», utilisés pour irriguer les prés et les vergers, sous la conduite du «garde pradier». Ces eaux faisaient également fonctionner plusieurs moulins qui produisaient de la farine et de l’huile. Mais la vie ne fut pas un long fleuve tranquille pour les Martrois du XVIIIe siècle. Pendant près de 60 ans, ils s’opposèrent à leurs seigneurs, propriétaires du moulin banal, dont les fermiers, abusant de leur situation de monopole, prélevaient des droits de mouture usuraires; à plusieurs reprises, des épidémies, frappant particulièrement les enfants, décimèrent la population; la clôture des vergers, privant les habitants du droit de vaine pâture, provoqua de véritables émeutes... La période révolutionnaire apporta son lot d’événements tragiques avec insurrections suivies de pillage et mort d’homme, démolition du clocher, arrestations de suspects, destruction d’arbres de la liberté... C’est durant cette période que la commune de Corent fut rattachée aux Martres. L’Empire ramena le calme mais, en 1814, Les Martres furent occupées pendant une quinzaine de jours par 175 cavaliers autrichiens et leurs 180 chevaux. La population fut respectée mais se vit imposer d’énormes réquisitions pour la nourriture de ce joli monde.La paix revenue, Les Martres entrèrent dans une période de prospérité. La vigne est à son apogée. Le port connaît un trafic intense: en 1837, 142 sapinières chargées de vin le quittèrent. En plus du vin, il était produit une pomme de qualité, elle aussi expédiée par l’Allier à Paris, où elle était vendue sous le nom de «pomme de bateau».
Au début du second Empire, un groupe d’opposants s’en prit à ses partisans les plus notoires en allumant onze incendies qui firent des dégâts considérables. Arrêtés, 4 d’entre eux furent condamnés à mort, 6 aux travaux forcés à perpétuité, 6 aux travaux à temps.En 1855, avec l’arrivée du chemin de fer et l’ouverture de la gare, vin, pommes et autres productions vont trouver un moyen plus sûr et plus rapide de gagner la capitale. La batellerie résistera quelque temps puis devra céder le pas au chemin de fer. En 1875, Corent obtient son" indépendance". La fin du XIXe siècle vit la construction du groupe scolaire ardemment désiré et celle d’un château d’eau qui permit d’alimenter quelques fontaines judicieusement réparties dans le bourg. C’est à cette époque que le phylloxéra toucha le vignoble auvergnat et finit par l’anéantir. L’activité économique s’en trouva profondément bouleversée, provoquant une longue période de déclin.
(Par Jean-Michel Maugue)